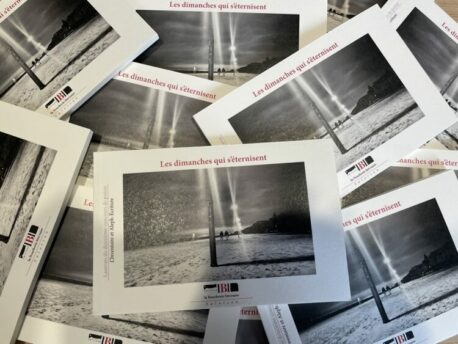L’Inventoire, Aleph-Écriture et le groupe Bayard (Notre Temps) vous remercient d’avoir été si nombreux à participer à notre concours « L’objet du souvenir ». Vous avez été 336 à nous envoyer un texte.
Le jury, composé d’auteurs-animateurs d’Aleph-Écriture, a longuement délibéré.
Après une première sélection de 21 textes, il a sélectionné 5 lauréats selon les critères suivants : respect du thème et la consigne de longueur, qualité de l’écriture (style, richesse du vocabulaire, fluidité et originalité), cohérence, authenticité et originalité de la voix narrative, émotion procurée à la lecture du texte.
Quelques mots du jury après la lecture de vos textes : « Difficile mais passionnant de faire émerger cinq textes. Chacun des auteurs a réussi à s’emparer de la proposition pour incarner l’objet et le transfigurer à travers l’émotion du souvenir et des diverses charges. Certains se sont davantage attachés à la matérialité de l’objet, d’autres ont fait vibrer subtilement l’émotion du souvenir … Les approches ont été multiples et riches. Merci à toutes et tous »
Voici les 5 textes lauréats !
Les textes sont affichés en ordre aléatoire. Le 1er prix sera annoncé lors de la remise des prix Aleph-Inventoire qui aura lieu le jeudi 11 décembre à 18h, au 9 rue de Saint-Petersbourg, à Paris dans le 8ème arrondissement. Le 1er prix sera publié dans le magazine Notre Temps. Le Lauréat remportera aussi un atelier de 2 jours « J’écris sur ma vie » au choix parmi ceux proposés par Aleph-Écriture.
Le massicot – Marie-Françoise Roger
Au fond du jardin, sous les grappes mauves de la glycine, une porte interdite. Quand je collais mon nez sur la vitre, je l’apercevais. Il brillait dans l’obscurité. Un fil d’acier, une lame de coupe, une guillotine prompte à s’abattre, le massicot trônait dans l’atelier de reliure de mon grand-père.
Le manche relevé laissait voir l’éclair de la lame. Suspendue, menaçante. Deux phalanges manquaient aux doigts de grand-père. La machine diabolique, tapie dans l’ombre, pouvait à la fois couper des doigts et faire des livres.
En 1942, l’artisan juif, le métèque, avait perdu ses clients et déserté son travail pour se cacher. À la fin de la guerre l’atelier était resté fermé. Je devais, à huit ans, me contenter d’apercevoir par la vitre embuée de poussière ce qui avait tranché ses doigts. Cet homme chétif, mon père l’avait connu exubérant, capable de dépenser en un instant le gain de la semaine pour offrir à son fils ce qu’il lui demandait. Plus rien de cela dans le visage taciturne. Le vieillard ne riait plus, ne faisait plus rire, ne fabriquait plus de livres.
À la mort de mon grand-père, le massicot a disparu.
La lame suspendue habite encore mes rêves. J’imagine les gestes du relieur. Serrer entre ses mains un paquet de feuilles, le tapoter sur la table, égaliser sous sa paume les bords à gauche, poser la pile de feuillets bien rangés sur le plateau de la machine, l’écraser sous la presse, rabattre la lame d’un coup sec. De fins rubans de papier s’effondrent sur le côté. La tranche du livre apparait, lisse, brillante. Couper net le haut des feuilles, tranche de tête, le bas, tranche de queue, le bord droit, tranche de gouttière. Coller le bord gauche des feuillets, brochés en cahier, sur une toile – le dos du livre, y graver des lettres d’or : L’Odyssée, L’Étranger, etc. Retourner le livre entre ses paumes, caresser du doigt la peau douce de la couverture, feuilleter les pages où dansent les mots. Couper, coller, créer. Gestes du relieur, gestes de l’écrivain.
Christmas 1914 – Pierre Guinet
La vieille maison se vide, discrète, à l’image de ma grand-mère, vêtue de gris rehaussé d’un col de dentelle. J’ai 15 ans ; j’ai accompagné mon père et mon oncle qui m’invitent à emporter un dernier souvenir. Mon choix se porte sur sa plaque de sage-femme et sur une petite boîte en laiton qui pourrait me servir de plumier. J’aime surtout la décoration soigneusement martelée du couvercle, mystérieuse : autour de l’effigie d’une jeune femme de profil et flanquée d’un M se trouvent deux inscriptions, « Impérium Britannicum » et « Christmas 1914 ». De chaque côté, France et Russia et aux quatre coins, Belgium, Servia, Japan et Monténégro.
Les années passent. Un jour que je baguenaude au long des ruelles du vieil Arras, mon regard tombe sur un exemplaire de « ma » boîte à la vitrine d’un petit magasin de brocante spécialisé dans les nombreux souvenirs de guerre de cette région. Interrogeant le maître des lieux j’apprends que la fameuse boîte a été spécialement confectionnée pour le premier Noël de la Grande Guerre et remise de la part de la princesse royale Mary à chaque soldat du contingent de la force expéditionnaire britannique. Elle devait contenir selon lui des cigarettes et du petit matériel de couture. Les inscriptions évoquent les pays alliés.
Ma grand-mère exerçait son métier de sage-femme à domicile dans une petite ville proche du front jusqu’à son évacuation lors de la dernière grande offensive allemande du printemps 1918. J’ai retrouvé, signé des autorités anglaises en 1916, un permis de circuler à bicyclette de nuit. J’imagine que, comme il était courant, elle hébergeait quelques soldats britanniques et que l’un d’eux lui a laissé cet objet en remerciement.
En fermant les yeux, je peux retracer son voyage au fond des tranchées, servant à recoudre un bouton de trench-coat, puis rangée parmi les souvenirs de cette femme dont le mari soldat n’était pas revenu.
La Moka- Carine Oger
Elle ne paye pas de mine, la Moka de mes ancêtres ! Pourtant, à elle seule, elle peut raconter l’histoire de ma famille sur plusieurs générations. Fidèle parmi les fidèles, elle est passée de mains en mains sans jamais faillir. Elle a sifflé sur la gazinière de ma grand-mère, et sur celle de sa mère avant elle. Elle a fourni un café revigorant à mes oncles maçons. Elle a accueilli les visiteurs de passage avec la merveilleuse odeur qu’elle dégageait.
Son apparence sobre et sa silhouette octogonale suffisaient à la distinguer parmi les ustensiles de cuisine, et à graver son souvenir dans nos mémoires. A chaque fois que je la prends entre mes mains, que je sens sa texture en aluminium, les souvenirs de ma grand-mère me reviennent. Je la vois tourner la base d’une main ferme, la remplir d’eau en faisant attention de ne pas aller au-delà de la limite. Elle déposait alors au-dessus le filtre en forme d’entonnoir et le remplissait de café moulu, italien bien sûr ! Elle le tassait un peu, juste ce qu’il fallait pour rajouter encore une petite cuillerée. Elle vissait ensuite avec poigne la partie haute, et déposait la cafetière ainsi fermée hermétiquement sur le feu à gaz.
C’était alors que la vraie magie commençait, celle que je retrouve encore avec ravissement à chaque fois que j’utilise cette cafetière. Le maître mot, c’était le silence. L’esprit en alerte, il fallait écouter attentivement la vie dans la Moka. La moindre inattention et le café serait mauvais. A peine émettait-elle un gargouillis qu’il fallait se dépêcher de la retirer du feu. Son chant résonnait dans la cuisine tandis que l’odeur du café chatouillait les narines. Il était temps alors de verser le liquide brun dans de petites tasses, et de savourer son goût corsé et riche en arômes.
Cette cafetière, et la tradition qui l’accompagne, me sont parvenues directement de ma « nonna » après son décès. Parfois j’ai la sensation de dialoguer avec elle tandis que j’écoute le bruit inimitable de l’eau qui monte.
Une boîte à neige – Marie Bourdon
Aujourd’hui, je ne joue plus. Je ne fabrique plus de mondes imaginaires, et les objets qui m’entourent me servent, dépourvus d’ombres et de poésie. Plus ils sont utiles, et moins leur présence est dense, et plus leurs formes sont encombrantes. Perdue dans une vie matérielle, je chéris la gratuité de cette boîte d’allumettes : vide, posée à l’angle du bureau, fourrée dans mon sac, glissée dans ma poche.
C’est un petit rectangle ancien, et maintenant gondolé, aux contours affaissés par le temps, et dont le motif a pâli : la flamme, qui envahissait le dessus de la boîte en volutes bleues et blanches, je dois faire un effort pour raviver son image, celle de l’instant où mon père me l’a donnée.
C’est presque la fin du jour, et il crie mon prénom, me dit de venir voir.
Debout devant la maison, dans le froid cinglant, il fume. Il se retourne à mon approche : son visage est transfiguré par une sorte de joie incompréhensible, et il me désigne quelque chose au loin, vers le ciel.
A six ans, je ne connais pas encore cette sorte d’éblouissement : sur la montagne, qui nous entoure toute l’année, tantôt verte, tantôt mauve, parfois presque noire sous la lumière crue, il a neigé.
Mon père pose son bras sur mes épaules, et nous regardons ensemble ce phénomène, si rare que je ne l’ai encore jamais vu. Et plus encore que sur la montagne la neige, c’est sur mon dos frêle le bras de mon père qui, ce jour-là, est mon paysage.
Puis, il rallume son cigare, considère un instant la boîte d’allumettes vide, et me la donne, me dit de la garder en souvenir : de son index jauni, il suit les contours de la flamme, en caresse les couleurs, me souffle qu’elle est semblable à la neige.
Cette boîte, je la regarde à mon tour, l’ouvre, la referme, la sens, passe mon doigt sur la tranche délavée de frottements. Elle contient le point aigu, inexplicable et perdu du lien le plus intense. Ce petit vide gris reste dense de la joie, de la neige, du corps mort de mon père et du temps persistant de l’enfance.
Un an – Agnès Petri
Il tient dans ma main.
Petit, lourd, cabossé. Gravé d’un triangle et de mots que seuls les égarés savent lire.
Sa surface rugueuse mord ma peau, froide et vivante à la fois.
On me l’a donné un soir d’hiver.
Le café tiédissait, les voix s’éteignaient, les chaises raclaient.
Autour de moi, des regards timides, des mains jointes, un silence qui tremblait un peu.
Mes doigts tremblaient aussi.
Ce n’était qu’un jeton — et pourtant, il pesait plus que toutes les bouteilles abandonnées, plus que tous les silences accumulés.
Au centre, un chiffre : un.
Un an.
Un monde pour moi.
Un an à respirer sans me noyer,
à marcher sans me dissoudre,
à réapprendre la soif — celle de l’air, du matin, du sourire d’un passant.
J’ai découvert qu’on pouvait boire la lumière, la laisser circuler dans chaque geste, chaque souffle.
Je le glisse dans ma poche. Les jours glissants, mes doigts le cherchent sans réfléchir.
Son froid murmure : « Tu es encore là. »
Parfois, je revois ce soir-là :
les mains qui me l’ont tendu, un sourire maladroit, un souffle court,
ceux qui savaient mais taisaient.
Il me relie à eux, à tous ceux qui ont tenu, chuté et se sont relevés.
Il n’est pas beau.
Il s’use, s’oxyde, se raye.
Chaque marque brille comme une cicatrice sous la lumière — témoin silencieux qu’on peut survivre à soi-même.
Il accompagne le silence du matin, le souffle furtif d’un inconnu, le goût amer du café.
Quand le doute s’installe, quand le monde menace de glisser entre mes doigts, il ne promet rien.
Il atteste seulement.
Peut-être qu’un jour je le rangerai, remplacé par un autre, frappé d’un nouveau chiffre.
Mais celui-ci restera le premier, le plus précieux.
Il ne dit pas : un an sans boire.
Il dit : un an à vivre.
Chaque fois que je le touche, je sais que je suis encore ici.
Que la lumière existe.
Et que tenir — simplement tenir — suffit parfois à renaître.
CC